Parcours astronomique
Ce parcours est composé de 21 étapes (environ 17 km). Départ au niveau du square Moisan.
Le Planétarium de Nantes, la Société d'astronomie de Nantes, le Laboratoire de Planétologie et Géosciences de Nantes, le Centre François Viète de Nantes Université et l'association Méridienne vous proposent un parcours consacré à l’astronomie à Nantes. Rues aux noms d'astronomes, objets patrimoniaux et lieux de sciences jalonneront votre trajet virtuel ou réel (plutôt à vélo !).

Ensemble gnomonique du Square Moisan
L'ensemble gnomonique du Square Moisan a été conçu par Jean-Michel Ansel en 1995. Il est composé d'un cadran solaire géant entouré de quatre stèles présentant des phénomènes astronomiques (éclipses, saisons, etc.)

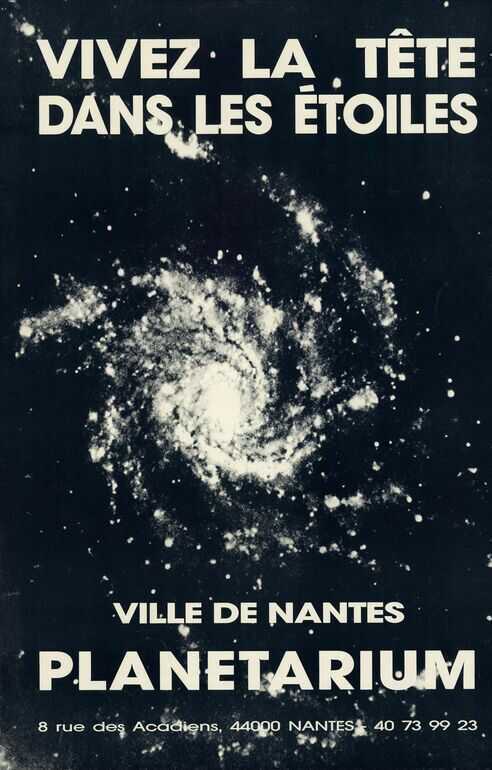
Planétarium de Nantes
Depuis 1981, sous son dôme de 8 mètres, le Planétarium de Nantes permet de découvrir l'astronomie, grâce à une salle de projection passée entièrement au numérique en 2005. Quelques météorites et maquettes occupent le hall d'accueil et complètent cette découverte.
En savoir plus sur le Planétarium de Nantes
Rue Arago
François Arago (1786-1853), né à Estagel dans les Pyrénées-Orientales, est avant tout connu comme physicien, promoteur de la théorie ondulatoire de la lumière. C’est également un homme politique, membre du gouvernement provisoire après la révolution de 1848 et signataire du décret d'abolition de l'esclavage. Pourtant, c'est surtout un astronome, directeur des observations à l'Observatoire de Paris, diffuseur de l'astronomie par son cours public paru à titre posthume sous le titre Astronomie populaire.
Avenue du Sextant
Le sextant est un instrument de navigation conçu au 18e siècle, doté de deux miroirs, l'un fixe et l'autre mobile. Il sert à mesurer des distances angulaires entre deux points. La mesure de la distance angulaire entre l'horizon et l'étoile polaire, par exemple, fournit la latitude du lieu.
Rue Jean-Baptiste Delambre
Jean Baptiste Delambre (1749-1822) doit sa célébrité actuelle à sa mesure du méridien de Paris, avec Pierre Méchain, pour établir le système métrique. Mais sa carrière d'astronome dépasse largement cet épisode. Membre de nombreuses institutions scientifiques, c'est aussi un grand enseignant et un historien de l'astronomie toujours considéré comme une référence.
Rue Camille Flammarion
Camille Flammarion (1842-1925) est sans doute l'un des vulgarisateurs de l'astronomie les plus talentueux. Après des débuts peu prometteurs comme calculateur à l'Observatoire de Paris, il publie en 1862 La pluralité des mondes habités. Ses chroniques dans les journaux et ses ouvrages lui valent une célébrité nationale et internationale. Il fonde en 1887 la Société astronomique de France.
Place Newton
Difficile de rendre compte de l’œuvre immense d’Isaac Newton (1642-1727) en quelques lignes. Sa théorie de la gravitation universelle, publiée en 1687, offre un cadre unique et mathématisé aux mouvements célestes. Dans ses Principia (traduits en français par Mme du Châtelet), il démontre entre autres, les trois lois de Kepler. C’est autour des années 1730 que la théorie de Newton commence à se diffuser en France, sous l’impulsion de Maupertuis et Voltaire. Toutes les recherches en mécanique céleste s’inscriront dans ce cadre, jusqu’à Einstein (1905). Les travaux d’optique de Newton ont aussi ouvert la voie au perfectionnement du télescope.
Place Edmée Chandon
Née en 1885 à Paris, Edmée Chandon entre à l'Observatoire de Paris en 1908 et y gravit les échelons de la carrière d'astronome. Membre incontournable du service méridien (en charge de la détermination et de la diffusion de l'heure), elle pilote des opérations internationales, devient experte de nouveaux instruments comme l’astrolabe à prisme, soutient une thèse et publie de nombreux articles, jusqu'à sa mise à la retraite par le régime de Pétain. Elle décède en 1944.
Rue Cassini
Jean Dominique Cassini (1625-1712) est un astronome italien, invité par Colbert à venir prendre les rênes de l'Observatoire de Paris nouvellement créé (1669). À l’aide des instruments qu’il y fait installer, il observe les planètes, découvre plusieurs satellites de Saturne et la division de l’anneau qui porte son nom. C’est le premier d’une dynastie de Cassini astronomes. Son fils Jacques, son petit-fils César-François et son arrière-petit-fils Jean Dominique lui succéderont à la tête de l’Observatoire. César-François Cassini est notamment connu pour sa Description géographique de la France parue en 1783.
Rue Copernic
L'astronome polonais Nicolas Copernic (1473-1543) fait ses études à Cracovie avant de les poursuivre en Italie où il s'initie à l'astronomie. Revenu dans son pays, il est nommé chanoine à Frombork qu'il ne quittera plus. L'année de sa mort, il publie le De Revolutionibus Orbium Coelestium, dans lequel il met la Terre en mouvement autour du Soleil. Par la suite, le système de Copernic prendra le nom d’héliocentrisme. Son ouvrage difficile n'est accessible qu'aux savants. C'est au siècle suivant qu'il bouleversera les mentalités : le système géocentrique, qui plaçait depuis l’Antiquité la Terre au centre de l’Univers, laisse place à l’héliocentrisme. La théorie de Copernic sera affinée grâce aux observations réalisées par Tycho Brahé et Galilée, et aux recherches théoriques de Johannes Kepler et Isaac Newton.
Ancien observatoire de la marine
Située rue de Flandres, cette tour de quatre étages, érigée par l'architecte Blon, fait partie de l'école d'hydrographie de Nantes, en service de 1828 à 1887. L'observatoire a un objectif chronométrique. Les navires en escale peuvent y déposer leurs chronomètres qui sont vérifiés à l'aide du mouvement des étoiles. Rappelons que les chronomètres servent à déterminer la longitude du navire, donc sa position sur l'océan. Les marins peuvent aussi être initiés à la navigation astronomique au sein de cet observatoire.
Rue Pierre Lévêque
Pierre Lévêque, né à Nantes en 1746, y devient professeur d'hydrographie. Il sera correspondant puis membre de l'Académie des Sciences. Il participe à l'aventure du ballon Suffren à Nantes, en 1784, qui s’inscrit dans les premières expériences de vols d’aérostats. Contrairement aux autres protagonistes qui souhaitaient s'inspirer des frères Montgolfier, Lévêque préconise et obtient un ballon gonflé à l'hydrogène qui volera à deux reprises à Nantes cette même année en transportant des passagers.
Méridienne de la place de la Bourse
Ce cadran solaire, utilisable autour de midi, est situé au numéro 8 de la place de la Bourse. Il a sans doute été conçu au 18e siècle. Depuis lors, le style (dont l'ombre donne l'heure) a disparu. De plus, un balcon a été ajouté au-dessus de la méridienne. Celle-ci est donc inutilisable.
Statues du passage Pommeraye
Dans le passage Pommeraye, deux sculptures retiennent notre attention. D'une part, le groupe personnifiant le jour et la nuit qui entoure l'horloge, d'autre part, la petite statue représentant l'astronomie, œuvres du sculpteur Jean Debay.
En savoir plus sur le Passage Pommeraye
Ancien observatoire de la maison de Graslin
Voilà deux siècles, en 1823, Jean-Joseph-Louis Graslin loue à la Ville de Nantes la tour de sa maison, située rue Molière, afin d'en faire un observatoire astronomique. Ce belvédère sur le port assure cet office jusqu'en 1832, date vraisemblable de sa destruction pour construire l'hôtel des Voyageurs.
Méridienne de l’Hôtel de ville
Contrairement à la méridienne de la place de la Bourse, celle de l'Hôtel de Ville est fonctionnelle. Elle a été érigée en 1842 par l'opticien nantais féru d'astronomie Frédéric Huette.
En savoir plus sur l' Hôtel de Ville
Ancienne école d'hydrographie de l’Hôtel de Briord
En 1672, une école d'hydrographie confiée aux Jésuites est créée à Nantes. Elle s'installe au 9 rue de Briord. La dernière observation importante est celle du passage de Vénus du 6 juin 1761. L'expulsion des Jésuites en 1762 engendre plusieurs années d'errance de l'enseignement hydrographique à Nantes.
Ancien observatoire de la tour sud de la cathédrale
Lors des guerres de Vendée, en 1793, un observatoire militaire est établi sur la tour sud de la cathédrale. La paix revenue, il est transformé en observatoire astronomique et sert à la formation des élèves de l'école d'hydrographie. Il s'agit d'une simple cabane en bois. Lorsqu'en 1796, un citoyen propose de raser la cathédrale pour faciliter la circulation, l'utilité de son observatoire est mise en avant pour la sauver de la destruction.
En savoir plus sur l’histoire de la Cathédrale de Nantes
Avenue Antarès
Antarès est une étoile de la constellation du Scorpion, tout d'abord connue sous le nom « Cœur du Scorpion ». On a découvert en 1819 qu'il s'agit d'une étoile double, un système stellaire composé de deux étoiles orbitant autour d’un même centre de gravité. C'est une supergéante rouge, ce qui signifie qu’elle est 12 fois plus massive que le Soleil et bien plus lumineuse. En terme de taille, Antarès est 700 fois plus grande que notre étoile.
Rue Urbain le Verrier
Urbain Le Verrier (1811-1877), ancien élève de Polytechnique, acquiert la gloire en 1846 en calculant la trajectoire d'une nouvelle planète, Neptune. Soutien fervent du Second Empire, il obtient la direction de l'Observatoire de Paris à la mort d'Arago. Il l'exerce de manière tyrannique, suscitant la résistance de ses collaborateurs.
Rue Pierre Bouguer
Pierre Bouguer, né au Croisic en 1698, débute sa carrière en succédant à son père Jean à la tête de l'école d'hydrographie de sa ville natale. Devenu membre de l'Académie royale des sciences, il fait partie d’une expédition envoyée au Pérou (actuel Equateur) en 1735 pour y mesurer un arc de méridien. Cette détermination doit permettre de trancher si la Terre est aplatie au pôle (théorie de Newton) ou allongée (théorie de Descartes). Son Traité de navigation est un classique de la période.